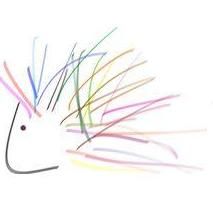Bernard Lahire, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, 2004.
Camille Hamidi | 11.11.2004
Analysant dans La culture des individus les pratiques culturelles des Français, Bernard Lahire poursuit son entreprise d'investigation des marges de la sociologie bourdieusienne. Sans nier les régularités statistiques associant les catégories sociales dominantes aux pratiques légitimes, et les pratiques peu légitimes aux catégories dominées, il choisit de s'intéresser aux cas nombreux, et même majoritaires, de dissonances culturelles internes aux individus. Si l'on peut émettre quelques réserves, notamment à l'égard d'une certaine forme de légitimisme à l'œuvre [...]
Bernard Lahire, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, 2004.
Michel Grossetti | 10.11.2004
La question des liens entre les hiérarchies sociales et les hiérarchies culturelles est à la fois fondamentale et difficile à traiter. Le constat empirique de corrélations statistiques entre les positions sociales (repérées par le niveau d’études ou la profession) et les pratiques culturelles (la consommation de différents produits culturels) peut en effet s’interpréter de bien des façons. On peut supposer par exemple que la position sociale influe sur les choix culturels, directement ou par l’intermédiaire de [...]
Groupe Frontière | 29.10.2004
La « frontière » est habituellement comprise comme la « limite de souveraineté et de compétence territoriale d’un État » De nos jours, la prégnance de cette définition semble s’estomper à l’échelle mondiale, accompagnant ainsi le processus de relativisation multiforme de l’État. Il faut y voir l’effet de l’évolution des techniques de transport et de communication, la dynamique et [...]
Joëlle Salomon Cavin | 13.09.2004
Le regard porté sur le territoire suisse est aujourd'hui loin d'être univoque. D'un côté, l'image d'une Suisse urbaine diffusée par des chercheurs, des associations qui militent en faveur des villes et par les offices fédéraux de statistique et d’aménagement du territoire. De nouvelles données et analyses sur le fait urbain ont permis le renouvellement de l’image de la ville en Suisse surtout considérées jusque-là pour leur impact négatif sur le territoire. Les villes sont devenues parties [...]
Egon Flaig | 29.06.2004
L’exercice de la majorité participe de la ritualisation de la vie politique en Occident. Jusqu’à quel point et pour quelle raison la « loi de la majorité » peut-elle être considérée comme un apport positif ? La loi de la majorité repose sur une abstraction qui a pour principe de traiter également tous les individus quelles que soient leurs autres caractéristiques. Elle n’implique pas la démocratie et peut contribuer au fonctionnement d’un pouvoir [...]
Entre deux lieux, entre recherche et récit.
Xavière Lanéelle | 07.04.2004
La mobilité quotidienne des Français s’est considérablement accrue au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les pratiques des habitants des villes – en termes de travail, de courses, de loisirs – se déployant dans un espace de plus en plus large. Nombreux sont désormais les individus qui travaillent dans une autre commune que [...]
Les fondements idéologiques du mythe de l’exode rural en France.
Béatrice Franques | 05.04.2004
La perspective diachronique des usages sociaux de la notion d'exode rural montre son intrication aux enjeux sociaux et politiques de la fin du 19e siècle, lorsque naît la Troisième république. De l'intérêt de formater le corps de la nation et d'en définir le référentiel territorial, les décideurs politiques de l'époque fondent leurs actions sur le groupe social des paysans, qui revêtent depuis cette période les attributs de la sédentarité. L'impératif territorial implique la stabilité du régime [...]
Philippe Lacour | 20.03.2004
Granger a développé durant toute sa carrière une réflexion très rigoureuse sur les sciences, dans la lignée de la tradition française du rationalisme appliqué. Son originalité profonde tient à une approche résolument comparatiste des différentes disciplines, de leurs méthodes, de leurs opérations et de leurs objets, dans le cadre d'une ambitieuse épistémologie, qu'on pourrait qualifier à la fois de pragmatiste et de transcendantale. Sa conception formelle de la connaissance réserve cependant un statut paradoxal à l'Histoire. [...]
Réflexions épistémologiques sur les constructions de l’objet géographique.
André-Frédéric Hoyaux | 17.02.2004
Cet article pose une réflexion sur les constructions territoriales et idéologiques qui s’établissent autour des objets géographiques « État » et « nation », à partir d’une déclaration du Ministre Président de la Communauté Française de Belgique indiquant qu’il n’y avait jamais eu ni nation ni État belge à proprement parler.Autour de l’exemple de la Belgique, de son évolution institutionnelle au fil de l’histoire contemporaine, entre une Belgique une et indivisible et une [...]
Cristina D’Alessandro-Scarpari, Élisabeth Rémy et Valérie November | 18.01.2004
En nous appuyant sur une étude de sociologie des sciences et des techniques portant sur une controverse autour d’une ligne à haute tension, nous avons l’intention de montrer que l’espace concerné contribue à remodeler et orienter la controverse, autant que celle-ci forge et modifie les espaces qu’elle touche. Avec la progression de l’analyse, la notion de lieu nous a semblé mieux adaptée à rendre compte de la complexité et de la variabilité de la géographie de [...]